Sébastien Girondt
Un chiffre d’affaires du commerce électronique évalué à quelque milliers d’euros en 1996 passant à plus de vingt milliards d’euros en 2009. Quinze millions de conteneurs transportés en 1980, contre 150 millions en 2010. Ces chiffres illustrent la manière dont la mondialisation a induit l'accroissement des échanges commerciaux internationaux. Cet accroissement s’accompagne de facto d’une multiplication des risques pour les entreprises, particulièrement en matière de transport de marchandises illicites, de contrefaçon ou encore de terrorisme. Pour faire face à ces risques, les entreprises mettent en place des procédés internes de prévention et développent une coopération étroite avec les autorités étatiques et internationales.
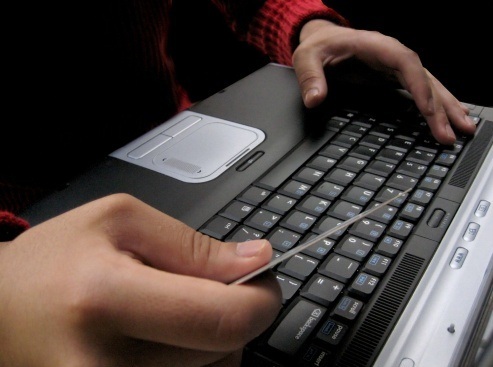
Nous pouvons noter, de surcroît, que les transporteurs et les sociétés de Poste sont eux aussi impliqués dans la lutte contre le transport de marchandises illicites, qui ne s'arrête pas à la contrefaçon. Combien de fois les douanes ont-elles saisi des stupéfiants transitant par voie postale? Plus sensible encore: le trafic d'armes. Transitant généralement par fret aérien, ferroviaire ou maritime à l'insu des transporteurs, les armes représentent, outre leur nature condamnable, un véritable risque pour la sécurité du personnel navigant. Ainsi, le secteur du fret aérien est particulièrement concerné par le « Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des Armes légères et de petit calibre (ALPC) sous tous ses aspects » mis en place par l’ONU.
Le secteur du transport maritime est d'autant plus exposé à ce risque, que "le taux de rotation des conteneurs relativement élevé dans le système commercial international et leur uniformité constituent autant de défis redoutables pour la sûreté. Le système est suffisamment perméable pour être facilement menacé et détourné de ses objectifs commerciaux légitimes", relève un récent rapport de l'OCDE sur la sûreté dans les transports maritimes.
La prévention des risques nécessite également une formation et une sensibilisation du personnel tant en matière d’utilisation des outils de veille que sur les diverses règlementations nationales et internationales auxquelles sont soumis leur secteur en général, et leur entreprise en particulier. De manière plus spécifique, dans les pays soumis à des embargo afin que cette dernière soit en mesure de les respecter et de mettre en œuvre des procédures internes permettant contrôler en amont les flux de marchandises. L’implication des salariés apparaît comme le facteur essentiel de prévention pour les entreprises car ils sont en contact permanent avec la clientèle.
Au contraire, dans le domaine des services Postaux et du transport maritime les acteurs économiques collaborent directement avec les autorités nationales. Cette collaboration est d’autant plus importante compte tenu des spécificités de ces secteurs. En effet, ces deux secteurs fonctionnent sur un système déclaratif. Ainsi, un transporteur maritime charge des conteneurs qui lui sont livrés scellés sans avoir connaissance du contenu, hormis ce qui est déclaré par le client sur les documents de transport. Ces documents sont remis à la douane et aux autorités locales qui accordent alors les autorisations d’exportation, et qui sont seules habilitées à vérifier le cas échéant leur contenu. Cette vérification des contenus peut être facilitée par la présence des agents des douanes dans les entrepôts des entreprises à l’instar des centres de tri de La Poste. Certaines entreprises du transport maritime combinent une politique d’information des autorités nationales en cas de suspicion et une gestion préventive des conteneurs, permettant une identification immédiate des boîtes suspectes ou celles que les autorités entendent contrôler.
Ainsi, les solutions mises en place par ces sociétés peuvent constituer des pistes pour les entreprises françaises impliquées dans le commerce international, particulièrement avec les Etats-Unis. Plus spécifiquement à l’heure où ce pays met en place un plan de lutte contre la cybercriminalité qui est élevée « au même rang que les actes terroristes ».